
Qu’ont-ils fumé ? demande le titre de la dernière couverture du magazine Fortune, au-dessus des visages des dirigeants des grandes banques américaines, et des montants qu’ils ont perdu. La réponse c’est qu’ils étaient sous l’emprise de la drogue habituelle : l’avidité.

par Paul Krugman, New York Times, 24 novembre 2007
« Qu’ont-ils fumé ? » c’est la question qui est posée en couverture du dernier magazine Fortune, accompagnée de photos de dirigeants de grandes banques récemment remerciés, et du montant de leurs énormes pertes. La réponse est, bien sûr, qu’ils étaient sous l’emprise de leur drogue habituelle : l’avidité. Ils ont tous pris des décisions socialement destructrices, encouragés qu’ils étaient par un système de régulation déficient, qui aurait dû être réformé dès les scandales d’Enron et de WorldCom, mais qui ne le fut jamais.
En fait, l’effondrement de Wall Street provient directement du grand plongeon de l’immobilier. Ce plongeon était prévisible et avait été prévu. J’avais écrit dès le mois d’août 2005 « Les américains se logent dans des maisons payées avec de l’argent emprunté aux Chinois. Cela n’est pas viable à terme ».
Alors que les alertes se succédaient, Wall Street a continué d’entasser des titres hypothécaires douteux. La plupart des investissements fautifs qui secouent aujourd’hui le monde financier semblent avoir été fait dans la frénésie finale de la bulle immobilière, ou même après que la bulle ait commencé à se dégonfler. Selon Fortune, Merrill Lynch a effectué ses plus gros achats de créances douteuses au cours de la première moitié de cette année, après que la crise des subprimes ait déjà été connue du public.
Maintenant que la facture arrive, tout le monde va devoir payer - sauf les responsables. Pourtant les pertes subies par les actionnaires de Merrill Lynch, Citigroup, Bear Stearns et autres ne sont pas les pires. En termes humains, bien plus importantes sont les centaines de milliers, peut-être les millions de familles américaines piégées dans des affaires d’hypothèque qu’elles n’ont pas comprises, et qui doivent maintenant faire face aux augmentations vertigineuses de leurs traites, avec dans beaucoup de cas, la perte de leurs maisons.
Il y a aussi les dommages collatéraux infligés à l’économie.
Certains soutiennent qu’en fait, le fiasco des subprimes n’est pas une grosse affaire. Il est vrai que même si les chiffres augmentent de jour en jour - certains observateurs parlent maintenant d’environ 400 milliard de dollars de pertes - ces pertes restent petites par rapport à la valeur totale de biens.
Mais ces mauvais investissements immobiliers paralysent des institutions financières qui jouent un rôle crucial dans fourniture de crédit, en asséchant une bonne partie de leur capital. Dans un récent rapport, Goldman Sachs indique que les pertes liées à l’immobilier pourraient forcer des banques et les autres acteurs à refuser 2000 milliards de dollars de prêts. C’est suffisant pour déclencher une violente récession, s’il cela se produit rapidement.
Au delà de tout cela, cela provoque une profonde crise de confiance, qui vient comme du sable dans les engrenages du système financier. Cette crise de confiance est clairement visible : il y a une répartition sans précédent entre les investisseurs qui acceptent des rendements très bas et qui sont prêts à acheter des obligations de l’Etat américain encore considérée comme sûres, et ceux qui recherchent des taux beaucoup plus élevés et auxquels les banques acceptent de consentir des prêts.
Comment les choses ont-elles pu se dégrader autant ? Une partie de la réponse est que ceux qui auraient dû être attentifs aux dangers, et prendre toutes les précautions, se sont comportés comme des américains moyens, optimistes et certains que tout était beau. Ils ont encouragé beaucoup trop de monde à prendre des hypothèques risquées. Oui, Alan Greenspan, c’est de vous qu’il s’agit. Une autre partie de la réponse est l’impunité dont ont bénéficié les hommes qui sont sur la couverture de Fortune. Aucun n’a été forcé de rendre les énormes chèques qu’ils ont reçu avant que la sottise de leurs décisions soit devenue apparente.
Il y a environ 25 ans, les monde américain des affaires - et le système politique américain - a accepté l’idée que l’avidité était une bonne chose. Les dirigeants se sont vus généreusement récompensés lorsque les compagnies qui les employaient semblaient réussir : l’année dernière les directeurs généraux de Merrill Lynch et de Citigroup ont été payés 48 millions de dollars et 25,6 millions de dollars, respectivement.
Certes, après n’avoir été qu’illusion, les succès se tarissent, mais certains parviennent encore à sauver leur mise : les acteurs les mieux placés gagnent, nous autres, le tout venant, nous perdons.
L’injustice est choquante ; pire, on encourage les mauvaises prises de risque, et parfois la fraude. Un dirigeant qui arrive à créer l’illusion du succès pendant quelques années peut s’en aller immensément riche. La révélation que les apparences étaient trompeuses sera le problème de quelqu’un d’autre. Tout cela est bien connu, et il faut que cela le soit. Ce sont les énormes salaires reçus par les dirigeants qui truquaient les comptes de leur entreprise qui ont abouti aux grands scandales d’il y a quelques années. Pour ce qui concerne la crise actuelle, si rien n’indique qu’il y a eu fraudes, la confiance du public a néanmoins été de nouveau trahie.
L’important est de bien voir que la crise des subprimes et l’effondrement du crédit est le résultat de notre échec à réformer efficacement le gouvernement d’entreprise après les derniers scandales.
John Edwards qui a récemment sorti un projet de réforme n’a pas bénéficié de beaucoup d’attention. Le gouvernement d’entreprise n’est toujours pas considéré comme un problème politique majeur, alors qu’il devrait l’être.
Paul Krugman est Professeur d’Economie à l’Université de Princeton et éditorialiste au New York Times. Son dernier livre s’intitule “ The Conscience of a Liberal”.


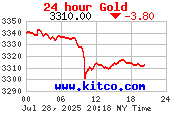
![[Most Recent Charts from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/silver/t24_ag_en_usoz_4.gif)